L’Asie-Pacifique nouveau centre du monde
Sophie Boisseau du Rocher, Christian Lechervy.
Odile Jacob, 2025
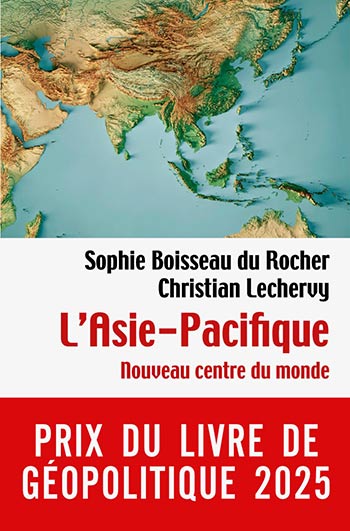
L’Asie-Pacifique regroupe dix-sept États d’Asie du Nord-Est et du Sud-Est (2,3 milliards d’habitants) reliés au bloc de civilisation sinisée, région en passe de retrouver sur la scène internationale sa place d’avant l’arrivée des Européens et qui refuse d’être le clone d’un Occident dont elle entend s’émanciper. S’esquisse ainsi un monde nouveau, fonctionnant sans l’universalité ni la puissance prédominante de ce dernier, avec la fierté d’avoir rendu justice aux ancêtres humiliés… Sa nouvelle puissance matérielle, pas seulement chinoise – 60% du PIB mondial, 66% de la croissance – conforte son ambition à renégocier sa relation avec une Europe que Mario Draghi diagnostique « en lente agonie », et à incarner une nouvelle modernité, avec ses initiatives les plus réfléchies pour désoccidentaliser l’ordre du monde. Une nouvelle centralité asiatique se dessine, qui déconstruit nos schémas de pensée habituels et vise nos prétentions universalistes. L’effet de miroir est déplaisant : l’Union européenne et ses
États sont-ils encore des partenaires fiables de la mondialisation ? Absence de vision réellement stratégique, de volonté géopolitique comme de moyens, admonestations, postures morales et menaces : le centre du monde s’interroge désormais à peine sur la place à nous concéder, sur fond de déclin européen nourri d’une perte de compétitivité et d’un potentiel retard technologique qui pourraient être fatals à son modèle social.
Un « capitalisme de bambou »
Zone économique la plus dynamique de la planète, où l’on perçoit le futur avec optimisme, l’Asie-Pacifique a migré de la périphérie au centre de l’économie-monde. En 2030, un membre sur trois de la classe moyenne planétaire y résidera et deux décennies plus tard le revenu par habitant (en parité de pouvoir d’achat) pourrait y avoir été multiplié par six… À l’avant-garde des villes intelligentes et de l’innovation – Singapour fait ici office de vitrine -, la région élabore un modèle asiatique de développement, fruit d’une histoire (on modernise, on n’occidentalise pas), d’une culture (la sinité), d’une éducation (la priorité) et d’une politique (des gouvernements « forts » et des États développeurs). Un recentrage asiatique voit s’accélérer une pragmatique intégration régionale – à commencer par la finance et les monnaies – et se conclure force accords économiques et de libre-échange (dont le RCEP représentant 17% du PIB mondial) : le commerce intrarégional a déjà dépassé celui avec les marchés européen et américain. Après la pax americana bientôt une pax asiatica ? Crédibilité de la dissuasion américaine, révolution militaire chinoise : les pays asiatiques refusent de se positionner entre les deux puissances, sachant que cette géopolitique des blocs les piétinerait. « Ne nous obligez pas à choisir », clame l’ASEAN, sur fond « d’asiatisation » des coopérations militaires. La démocratie occidentale ne fait plus rêver. Confrontées à la tâche de créer des États-nations modernes, les sociétés asiatiques façonnent des formes paternalistes de pouvoir, satisfaisant le besoin de sécurité et de stabilité, propices à la croissance. L’Asie orientale a clairement démontré l’invalidité de la thèse selon laquelle cette démocratie est nécessaire à la modernité…
« L’Asie aux asiatiques »
L’Occident suscite encore admiration, mais de plus en plus de rejet. C’est un régionalisme informel consensuel, souple qui se met en place, fort différent de l’expérience européenne, plus légaliste et soumise à des règles de droit arbitrales : les résultats avant les concepts… Les présents problèmes de l’Occident ont ébranlé l’évidence voulant qu’un régime politique fondé sur la garantie des libertés favorise nécessairement développement et puissance d’un pays. Tiraillée entre bonnes intentions et naïveté, dotée d’une vision géopolitique clivée et souvent dépassée, l’Europe sera-t-elle au rendez-vous alors que l’Asie-Pacifique a intérêt à jouer la multipolarité ? Les stratégies indopacifiques constituent peut-être une réponse.
Tandis que s’érodent valeurs et influence de l’Occident, le siècle de l’Asie est réalité, mais n’a pas encore produit un nouvel ordre mondial. L’écart comme trait d’union : « Si nous savons opérer une révolution copernicienne de nos mentalités, le développement de l’Asie-Pacifique va avoir une capacité d’entraînement dont l’Europe bénéficiera » concluent les auteurs. Spécialiste de l’Asie du Sud-Est, chercheuse à l’Institut français des relations internationales (IFRI), Sophie Boisseau du Rocher cosigne avec Christian Lechervy, ancien ambassadeur en Birmanie et auprès de la Communauté du Pacifique, un ouvrage aussi remarquable par sa réflexion que sa documentation.
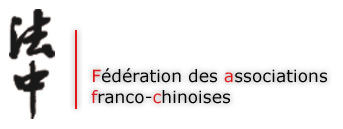

Réagir